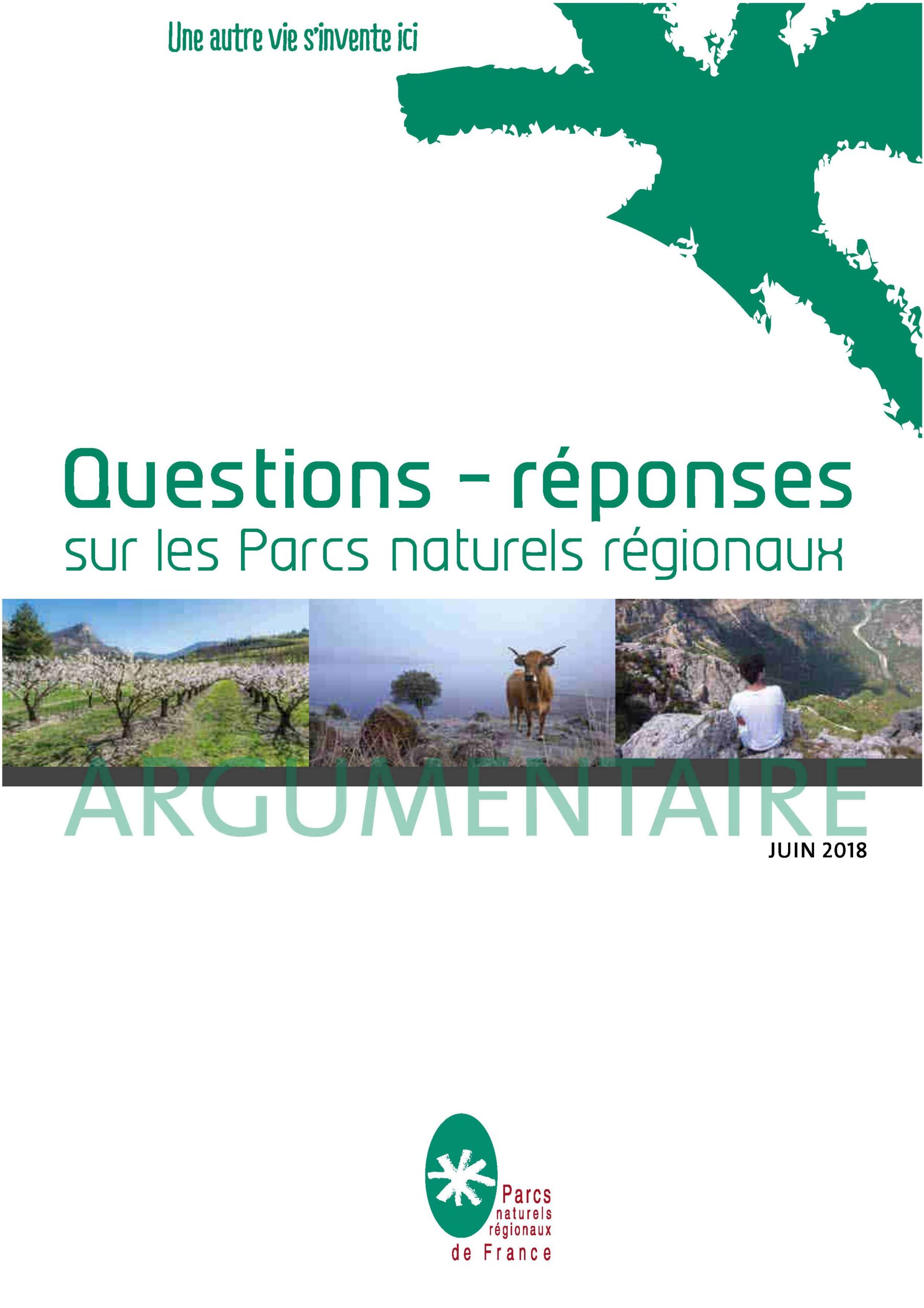QU’EST-CE QU’UN PNR ?
DÉFINITION D’UN PNR
Un Parc naturel régional (PNR) est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine.
Un “Parc naturel régional” est un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Le classement en Parc naturel régional qui repose sur des critères de classement ne se justifie que pour des territoires dont l’intérêt patrimonial est remarquable pour la région et qui comporte suffisamment d’éléments reconnus au niveau national et/ou international.
Les Parcs naturels régionaux ont pour mission d’asseoir un développement économique et social du territoire, tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager. La richesse des Parcs réside dans la transversalité dont ils font preuve, en intégrant les enjeux de biodiversité à leurs projets de territoire.
Les territoires de Parcs se caractérisent par des résultats et des spécificités qui les distinguent des autres territoires.
Les Parcs Naturels Régionaux se distinguent
des Parcs Naturels Nationaux par leurs objectifs
Le Parc Naturel Régional (PNR) |
Le Parc National |
||
|---|---|---|---|
| Créé | Par décision du Conseil Régional après agrément de la charte par décret | Par décision gouvernementale | |
| Géré | Par un Syndicat Mixte de Collectivités locales | Par un établissement public national | |
| Possède | Peu ou pas de réserves intégrales | Des réserves intégrales | |
| Chasse, pêche | Non limitées | Limitées | |
| Activités humaines |
Pas de réglementation particulière hormis le Droit Commun | Astreintes à une réglementation | |
| Accès | Libre | Peut être réglementé | |
| Buts | – Protection des richesses naturelles – Accueil dans la zone même du parc – Développement économique rural – Animation culturelle, pédagogique de plein air |
Sauvegarde du milieu naturel surtout dans un but scientifique | |
Structure des Parcs Naturels Régionaux
LES CRITÈRES DE CLASSEMENT
Qualité et caractère du patrimoine :
- caractère remarquable du patrimoine pour la région concernée
- éléments de patrimoine présentant un intérêt reconnu au niveau national et/ou international
- périmètre cohérent et pertinent par rapport au patrimoine, à l’identité du territoire.
Qualité du projet :
- précision des orientations et mesures proposées en réponse au diagnostic et aux enjeux du territoire,
- projet concernant l’ensemble des partenaires locaux (élus, agriculteurs, entreprises, associations de protection de la nature, culturelles, d’habitants, administrations,…)
Capacité de l’organisme de gestion à conduire le projet :
- adhésion des collectivités (communes, régions, départements,…)
- moyens humains et financiers pérennes
- partenariats et concertation formalisés (conventions, accords, contrats d’objectifs,…)
Les cinq missions des Parcs naturels régionaux
Préserver le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée des milieux et des paysages : voilà une mission bien naturelle pour les Parcs.
Chacun des Parcs possède un service consacré à l’environnement et met en place des programmes de recherches scientifiques, des mesures de protection de la faune, de la flore et des paysages. Les Parcs luttent également contre les pollutions, qu’elles soient de l’eau ou de l’air et s’engagent avant tout sur le changement climatique. Côté patrimoine culturel, il s’agit surtout de le faire vivre. Par des expositions, des musées, des circuits de découverte, des animations, des spectacles…
Dans un Parc, tout le monde doit s’épanouir, la nature comme les populations.
Pour les Parcs, c’est une mission reconnue tardivement mais fortement ancrée aujourd’hui. On privilégie les activités économiques respectueuses de l’environnement. Celles qui valorisent les ressources naturelles et humaines. Le tourisme vert, la vente à la ferme, l’agriculture bio ou raisonnée, les nouvelles technologies et les savoir-faire locaux par exemple. On y expérimente la transition écologique avec des systèmes de déplacement, de chauffage ou de production énergétiques alternatif
Depuis leur origine, les Parcs jouissent d’une immense liberté. Ils ont toute latitude de tester et d’expérimenter. Et ne s’en privent pas. Les Parcs s’engagent dans des expériences pilotes, dans des projets européens… C’est pour cela que l’on trouve dans les Parcs des projets audacieux, parfois inattendus. La plupart du temps, ces actions sont évaluées et réajustées en fonction des observations recueillies.
La mission « Education » des Parcs mobilise, grâce à ses méthodes d’éducation populaire, dynamiques et modernes, un nombre toujours plus important de participants. La spécificité des Parcs repose sur leur capacité à fédérer les acteurs d’un territoire et à aborder de façon transversale l’ensemble des enjeux locaux ou globaux. Elle concerne tous les publics.
Gouvernance et partenariat
Pour répondre à ces divers enjeux, la politique des PNR repose sur une gouvernance originale « mise en place pour la mise en œuvre d’un projet de développement du territoire partagé et librement consenti entre les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et l’Etat », souligne la circulaire sur les Parcs
L’Etat et les collectivités territoriales concernées doivent appliquer ses orientations et ses mesures dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent. L’Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l’organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions.
La politique des Parcs naturels régionaux est initiée, négociée, voulue et mise en œuvre par les élus locaux. Les élus des communes du Parc en sont la cheville ouvrière; les élus régionaux et départementaux en sont les partenaires privilégiés. Les conseils régionaux et conseils généraux sont les principaux financeurs des Parcs naturels régionaux.
Les autres partenaires (non élus locaux) d’un Parc naturel régional sont les forces vives locales, c’est à dire :
- les représentants socioprofessionnels (à travers leurs chambres consulaires, syndicats professionnels, etc.),
- les diverses associations.
CONVAINCRE PLUTÔT QUE CONTRAINDRE
Pour répondre à ces divers enjeux, la politique des PNR repose sur une gouvernance originale « mise en place pour la mise en œuvre d’un projet de développement du territoire partagé et librement consenti entre les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et l’Etat », souligne la circulaire sur les Parcs
L’Etat et les collectivités territoriales concernées doivent appliquer ses orientations et ses mesures dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent. L’Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l’organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions.
La politique des Parcs naturels régionaux est initiée, négociée, voulue et mise en œuvre par les élus locaux. Les élus des communes du Parc en sont la cheville ouvrière; les élus régionaux et départementaux en sont les partenaires privilégiés. Les conseils régionaux et conseils généraux sont les principaux financeurs des Parcs naturels régionaux.
Les autres partenaires (non élus locaux) d’un Parc naturel régional sont les forces vives locales, c’est à dire :
- les représentants socioprofessionnels (à travers leurs chambres consulaires, syndicats professionnels, etc.),
- les diverses associations.
LA GESTION DES TERRITOIRES DES PARCS - LA CHARTE
La charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de protection et de développement durable élaboré pour son territoire. Après avoir été soumise à enquête publique, elle est approuvée par les communes constituant le territoire du Parc, la (ou les) Région(s) et Départements concernés, les partenaires socioprofessionnels et associatifs…
- Le PNR est régi par sa charte, mise en œuvre sur le territoire du parc par un syndicat mixte de gestion.
- La charte du PNR est établie à partir d’un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d’une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence
- Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre.
- Elle permet d’assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités publiques.
- Elle a une validité de 15 ans
- Elle définit les domaines d’intervention du syndicat mixte et les engagements de l’Etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en œuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu’elle détermine.
La charte comprend divers documents :
- un rapport qui détermine les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ;
- un plan du périmètre d’étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s’appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport et qui caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
La charte n’entraîne aucune servitude ni réglementation directe à l’égard des citoyens. En revanche, les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) ou tout document d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte du parc.